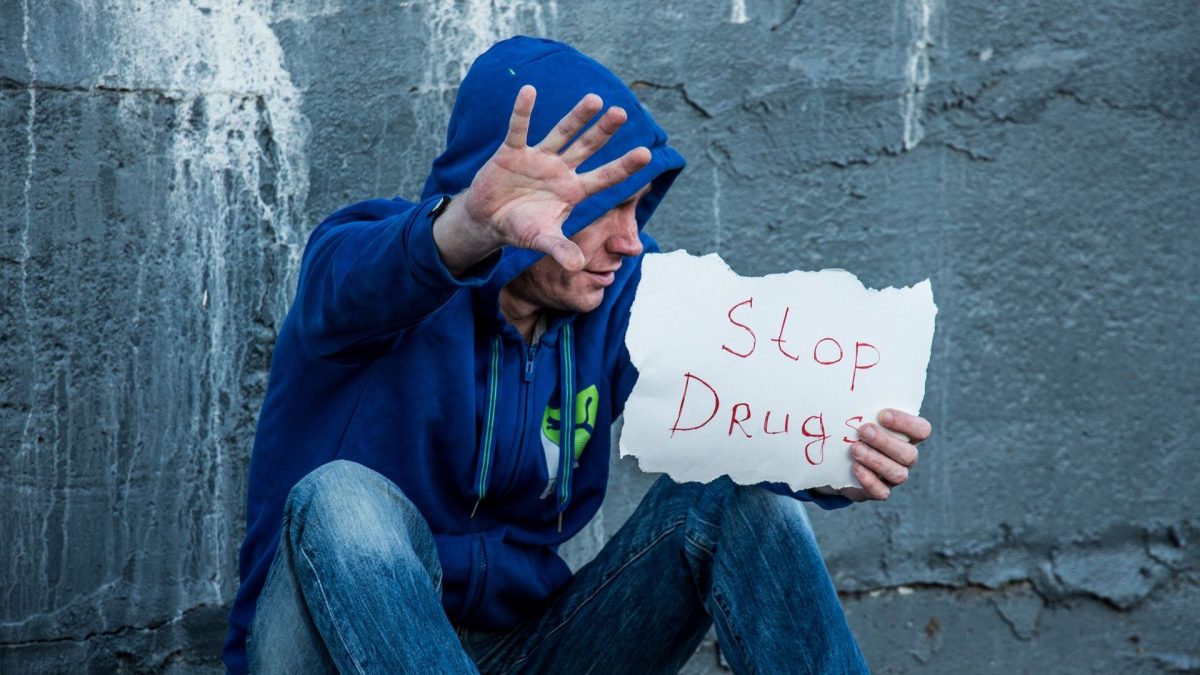Par Atilio Faoro
Françoise Thom dévoile le scandale des accords qui ont armé le Kremlin. Dans deux essais publiés en septembre 2025 sur Desk Russie, l’historienne prouve qu’un siècle de commerce avec Moscou – de Lénine à Poutine – a servi non à élever le peuple russe, mais à renforcer ses dictateurs : usines Ford, gazoducs sibériens, contrats Mistral… tous détournés pour l’arsenal du Kremlin.
Elle démonte le mythe du « commerce pacificateur » : séduire, capter, puis spolier l’Occident est la méthode constante de Moscou. Chaque génération occidentale s’y laisse reprendre ; sans lier les échanges à la vérité et à la liberté, le commerce devient complicité avec le mal.
——————————
Il arrive que l’histoire, soigneusement enfouie sous les archives et les discours officiels, remonte brusquement à la surface et vienne bousculer nos certitudes. C’est ce que vient de faire Françoise Thom, historienne française, agrégée de russe, spécialiste de l’URSS, qui a enseigné à la Sorbonne et a passé quatre ans en Union soviétique dans les années 1970. Sa connaissance intime du système communiste, nourrie d’archives et de souvenirs vécus, lui donne un ton d’autant plus incisif qu’il ne s’embarrasse pas des fables diplomatiques.
En septembre 2025, elle a publié sur le site Desk Russie – un think-tank animé par des universitaires et des dissidents russes ou est-européens, connu pour alerter l’opinion sur l’impérialisme russe et la désinformation du Kremlin – deux longs essais qui devraient faire date : – le 7 septembre 2025, « Les échanges économiques, une arme méconnue dans la guerre hybride du Kremlin contre l’Occident. I : L’empreinte léninienne » [1] ; – le 28 septembre 2025, « … II : La contagion » [2].
Ces deux textes, très documentés, retracent plus d’un siècle d’illusions : comment, de Lénine à Poutine, le pouvoir russe a utilisé le commerce avec l’Occident non pour développer son peuple, mais pour renforcer son régime et affaiblir ses adversaires. Cette thèse paraît choquante ; elle ne l’est que parce qu’elle met à nu ce que le langage diplomatique a longtemps recouvert d’euphémismes.
Françoise Thom commence en 1918. La Russie bolchevique est alors exsangue ; pourtant Lénine devine qu’il peut se maintenir s’il parvient à attirer le savoir-faire occidental. Il tend donc la main aux industriels allemands, britanniques, français et américains. Mais derrière les sourires, voici ce qu’il écrit en privé à Kamenev : « Notre monopole sur le commerce extérieur est un avertissement poli : mes chers, le moment viendra où je vous pendrai pour cela » [3]. Dans une autre lettre, il confie qu’il faut « exploiter la rapacité des capitalistes pour leur extorquer des avantages qui renforceront notre position » [4]. Tout est dit : la coopération n’est qu’un leurre tactique.
Les démocraties, elles, persistent à croire aux vertus civilisatrices du marché. Le Premier ministre britannique Lloyd George, en mars 1920, déclare : « Nous avons échoué à tirer la Russie de sa folie par la force ; je crois que nous pouvons la sauver par le commerce… Nous devons combattre l’anarchie par l’abondance » [5]. La naïveté de cette phrase résume le malentendu qui hantera un siècle de relations Est-Ouest : l’Occident prête au Kremlin ses propres intentions ; le Kremlin y voit un instrument de puissance.
Le même schéma se répète. Dans les années 1920-30, l’Allemagne et l’Angleterre investissent massivement ; puis Staline fait venir des géants occidentaux : Ford conçoit l’usine automobile de Gorki ; l’architecte industriel Albert Kahn Inc. supervise la construction de plus de 520 usines ; General Electric livre turbines et générateurs. Une fois le savoir-faire absorbé, le régime invente des procès de sabotage : le procès de Chakhty (1928) et l’affaire Metropolitan-Vickers (1933) frappent ingénieurs soviétiques et experts britanniques [6]. Le message est clair : merci pour la technologie, vous pouvez partir… ou être accusés.
Après 1945, le décor change : on parle de « détente », de « coexistence pacifique ». Mais les documents cités par Thom révèlent la continuité stratégique. Un mémo est-allemand du 26 avril 1968 prescrit : « Il faut rallier les élites économiques européennes influentes au moyen de la coopération et réduire l’influence américaine » [7]. Les grands contrats Est/Ouest – usine Fiat-Togliatti (1966), complexe KamAZ, gazoducs sibériens – transfèrent technologies civiles et militaires (dual-use) et alimentent la montée en puissance du complexe militaro-industriel soviétique [8]. L’Occident croit désamorcer le conflit par l’interdépendance ; Moscou renforce son arsenal et divise ses adversaires.
L’effondrement de l’URSS en 1991 fait espérer un tournant. Mais sous Boris Eltsine, l’État russe vit « sous perfusion » : les plans du FMI et de la Banque mondiale injectent 66 milliards de dollars ; dans le même temps, 150 à 200 milliards s’évaporent par des circuits off-shore [2]. L’audit commandé au cabinet PwC révèle que la Banque centrale de Russie, via une société-écran installée à Jersey (FIMACO), spéculait sur sa propre dette pour maquiller ses réserves [9]. Le procureur Iouri Skouratov, qui tente de dénoncer ces détournements, est piégé par un « kompromat » télévisé monté par le FSB alors dirigé par Vladimir Poutine ; l’enquête est enterrée[10].
Arrivé au pouvoir, Poutine assume sans fard : en 2008 il déclare que la priorité absolue est « l’acquisition de capacités scientifiques et technologiques avancées » [11]. Plus tard, il lâche cette phrase brutale : « Nous devons les étrangler… je le dis sans hésitation » [12], visant les entreprises occidentales vues comme des ennemis potentiels de l’État russe.
Le mécanisme reste inchangé : séduire d’abord, capter capitaux et savoir-faire, puis durcir les conditions et confisquer. L’accord de 2011 sur les navires d’assaut Mistral construits par la France pour la marine russe sera décrit comme « le plus grand transfert d’équipement militaire sensible d’un pays à un autre dans l’histoire »[13]. Après 2014, malgré l’embargo européen, des composants français (Thales, Safran) modernisent chars et avions russes. En 2022, le groupe Renault, piégé entre sanctions et pressions, doit céder pour un rouble symbolique sa participation majoritaire dans AvtoVAZ (Lada) ; la même année, Moscou s’empare d’actifs étrangers – Danone, Carlsberg, projets Sakhaline-I et II – par décret présidentiel [2].
Ce récit, ponctué de citations directes, dévoile une constante que nos sociétés préfèrent oublier : les dirigeants russes considèrent le commerce comme un outil de guerre, et la naïveté de leurs partenaires comme une ressource stratégique. Chaque génération occidentale croit inaugurer un nouveau départ ; chaque génération se heurte au même scénario : promesses de coopération, transferts de capitaux, divisions internes, puis harcèlement juridique et spoliation.
Relire ces archives produit un malaise : derrière les poignées de main et les discours sur la paix par le commerce, on retrouve l’avertissement de Lénine : « Le moment viendra où je vous pendrai pour cela. » Ce n’est pas une boutade : c’est une méthode.
Et puisque cet article s’adresse à des lecteurs catholiques attachés à la foi et à la justice, il n’est pas inutile de rappeler que l’Évangile nous avertit : « Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents » (Mt 10, 16). La Doctrine sociale de l’Église n’est pas une option pieuse : elle éclaire la vie économique. Elle nous rappelle que le commerce n’est pas neutre ; il doit toujours être ordonné à la dignité de la personne humaine, au bien commun, à la liberté des nations et à la vérité. Une coopération économique qui sert de fait à étouffer un peuple, à alimenter une machine de guerre ou à entretenir le mensonge devient une complicité avec le mal, même si elle semble profitable à court terme. Nous ne pouvons pas nous contenter d’échanger des capitaux et des technologies sans interroger la finalité de ces échanges. Le chrétien est appelé à lier profit et vérité ; il ne doit jamais fermer les yeux sur le prix moral de ce qu’il finance.
Cette lucidité ne mène pas au désespoir : elle invite à la vigilance et à l’espérance. Nous pouvons encore choisir de privilégier des partenariats transparents et réversibles, refuser les dépendances stratégiques qui livrent notre sécurité et notre liberté aux mains d’un régime prédateur, soutenir les peuples meurtris — l’Ukraine en premier — et aussi ces Russes qui, au péril de leur vie, refusent de servir le mensonge.
Enfin, et surtout, nous pouvons prier pour que la vérité triomphe : « La vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32). Dans ce champ de bataille discret qu’est l’économie mondiale, le chrétien ne doit jamais cesser de porter la justice, la vérité et la charité. C’est là, plus que dans les contrats et les chiffres, que se joue la vraie victoire.
Articles de Françoise Thom :
Les échanges économiques, une arme méconnue dans la guerre hybride du Kremlin contre l’Occident. I. L’empreinte léninienne
Les relations économiques, une arme méconnue dans la guerre hybride du Kremlin contre l’Occident. II. La contagion
Photos : Défilé du jour de la Victoire à Moscou 2023 Kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons. Lenine, Viktor Bulla, Public domain, via Wikimedia Commons. Poutine, Kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.
Notes :
[1] Françoise Thom, « Les échanges économiques, une arme méconnue dans la guerre hybride du Kremlin contre l’Occident. I : L’empreinte léninienne », Desk Russie, 7 septembre 2025.
[2] F. Thom, « … II : La contagion », Desk Russie, 28 septembre 2025.
[3] V. Lénine, lettre à L. Kamenev, 3 mars 1922 : « Notre monopole sur le commerce extérieur est un avertissement poli : mes chers, le moment viendra où je vous pendrai pour cela. » Cité par F. Thom, art. I.
[4] Lénine : « … exploiter la rapacité des capitalistes pour leur extorquer des avantages… » Cité par F. Thom, art. I.
[5] David Lloyd George, déclaration à la Chambre des communes, mars 1920 : « … nous avons échoué à tirer la Russie de sa folie par la force ; je crois que nous pouvons la sauver par le commerce… » Cité par F. Thom, art. I.
[6] Procès de Chakhty (1928) et procès Metropolitan-Vickers (1933), affaires de « sabotage » visant des ingénieurs soviétiques et britanniques. Cités par F. Thom, art. I.
[7] Mémo du SED (RDA), 26 avril 1968 : « … rallier les élites économiques européennes influentes… » Cité par F. Thom, art. II.
[8] Exemples de transferts technologiques civilo-militaires : accord VAZ-Fiat (1966, usine Togliatti), complexe KamAZ, gazoducs Sibérie-Europe. Cités par F. Thom, art. II.
[9] Audit du cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC) pour le FMI (1998) sur la Banque centrale de Russie : utilisation de la société off-shore FIMACO (Jersey) pour gonfler artificiellement les réserves et spéculer sur sa propre dette. Cité par F. Thom, art. II.
[10] Affaire Iouri Skouratov (1999) : le procureur général russe enquêtant sur les détournements de fonds fut écarté après diffusion d’un kompromat préparé par le FSB alors dirigé par V. Poutine. Cité par F. Thom, art. II.
[11] Vladimir Poutine, 2008 : déclaration sur « l’acquisition de capacités scientifiques et technologiques avancées » comme priorité absolue de la Russie. Cité par F. Thom, art. II.
[12] V. Poutine : « Nous devons les étrangler… je le dis sans hésitation », propos rapportés dans F. Thom, art. II.
[13] Contrat des navires Mistral entre la France et la Russie (17 juin 2011) : « le plus grand transfert d’équipement militaire sensible d’un pays à un autre », Defense News, P. Tran, 17-06-2011 ; cité par F. Thom, art. II.